- C.D.A.C.I.
- Collection Droit, biotechnologies et société
- Droit administratif
- Droit autochtone
- Droit civil
- Droit constitutionnel
- Droit des affaires
- Droit des technologies
- Droit international
- Droit pénal
- Droit public général
- Jurisprudence
- Les conférences Albert-Mayrand
- Les conférences Roger-Comtois de la Chaire du Notariat
- Les Conférences Chevrette-Marx
The Chevrette-Marx Lectures - Les journées Maximilien-Caron
- Lois et règlements
- Méthodologie
- Théorie du droit
- Titres parus antérieurement

- Études de sociologie du droit et de l’éthique, 2e éd.
- Guy Rocher †
- ISBN : 978-2-89400-371-8
- Date de parution : 2016-06-01
614 pages
80,00$

Depuis la publication de cet ouvrage, en 1996, j’ai écrit un bon nombre de textes abordant des thèmes reliés à la sociologie du droit et de l’éthique. Il est apparu pertinent d’en choisir un certain nombre et de préparer une nouvelle édition. Les nouvelles « études », tout comme les précédentes, proviennent de recherches empiriques et de réflexions théoriques menées depuis une trentaine d’années au Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal.
L’autonomie du droit est relative. Il s’inscrit en effet dans la vie concrète d’institutions variées et il est, pour cette raison, traversé par les valeurs, les idéologies et les rapports de pouvoir qui prévalent dans une société. C’est dans l’analyse de ces interactions entre le droit et le milieu social, économique, politique et culturel que la sociologie du droit trouve sa raison d’être.
Le droit positif est par ailleurs en constante liaison avec d’autres ordres normatifs, celui des administrations, des sciences, des religions, etc. Force est alors de constater, dans ce contexte, la convergence entre l’emprise croissante du droit sur les relations sociales et la prolifération de la réflexion éthique sur l’inquiétude humaine dans les sociétés contemporaines.
Du coup, la sociologie du droit et celle de l’éthique s’imbriquent dans une sociologie générale des formes de régulation sociale, c’est-à-dire de la pluralité des règles – formelles et informelles – qui ordonnent la coexistence des individus dans une société.

- Droit préventif - Le droit au-delà de la loi (2e édition)
- Pierre Noreau
- ISBN : 978-2-89400-365-7
- Date de parution : 2016-01-20
176 pages
35,00$

- En 1993, l’ouvrage Droit préventif était publié alors que les idées qu’il proposait ne trouvaient que peu de résonance au sein de la communauté juridique québécoise. Depuis cette époque, l’idée que le droit s’exprime, hors de la forme législative et réglementaire, dans les conventions qu’établissent continuellement les citoyens entre eux, a intégré le champ de la pratique juridique. Le développement de la médiation familiale, de la conciliation judiciaire en matière civile ou de la justice réparatrice en matière criminelle a mis en évidence la présence de mécanismes sociaux qui rétablissent les citoyens comme acteur de leur propre normativité.L’objet de cet ouvrage est de décrire ces mécanismes et de démontrer la nature essentiellement préventive et sociale du droit. Au-delà de sa capacité à pacifier les rapports conflictuels, le droit y est en effet défini comme une forme de la relation sociale. La normativité juridique se voit du coup rétablie dans sa fonction régulatrice, c’est-à-dire comme mécanisme de prévision des comportements et, partant, comme mécanisme de prévention des différends.
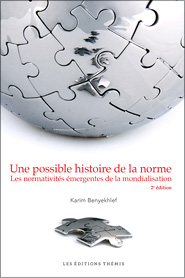
- Une possible histoire de la norme — Les normativités émergentes de la mondialisation, 2e ed
- Karim Benyekhlef
- ISBN : 978-2-89400-346-6
- Date de parution : 2015-03-12
921 pages
103,00$

- L'architecture normative des sociétés occidentales contemporaines se transforme sous l'action conjuguée de la globalisation des échanges commerciaux et financiers, de l'inflexion économiste assignée aux modes de gouvernance de l'administration publique, de la mondialisation des risques et de l'intensification des interdépendances étatiques. La mondialisation bouscule le monopole de l'État sur le droit en illustrant notamment les difficultés de celui-ci à réguler des phénomènes globaux, comme les menaces à sa sécurité ou les risques environnementaux. Cet ouvrage se propose de dresser un inventaire des incidences de la mondialisation sur le droit. Une perspective historique soutient cet inventaire et permet ainsi de mieux apprécier l'évolution de la capacité de dire le droit de l'État, premier attribut de sa souveraineté. Quelles sont les limites du droit moderne au regard de la mondialisation? Comment concilier la souveraineté de l'État avec les multiples interdépendances qui l'enserrent au plan normatif ? Quelles sont les formes possibles d'une gouvernance globale? Comment assurer une gouvernance démocratique des affaires globales? Quelle est la place de l'État-nation dans l'élaboration d'un droit global, voire postnational? Comment situer les rapports entre le droit étatique et les normativités émergentes de la mondialisation? Ces questions, et bien d'autres, sont au cœur des développements du présent ouvrage.

- Mélanges Pierre Ciotola
- Brigitte Lefebvre
- Antoine Leduc
- ISBN : 978-2-89400-321-3
- Date de parution : 2012-12-03
553 pages
73,50$

Pierre Ciotola incarne l'universitaire dans l'acceptation la plus classique du terme. Professeur dans l'âme, Pierre est d'abord l'homme qui a consacré la plus grande partie de son énergie à l'enseignement. Pendant 40 ans, guidé par une implacable rigueur intellectuelle, cet orateur hors pair aura formé et largement influencé la pensée juridique de milliers d'étudiants. On lui doit aussi une oeuvre doctrinale exceptionnelle qui déborde largement les limites du droit des sûretés, son domaine de prédilection. Sa production, riche et diverse, témoigne ainsi d'une hardiesse et d'une curiosité intellectuelle dont seuls les plus grands peuvent s'enorgueillir. Être sensible et généreux, la Faculté, ses collègues et ses étudiants ont toujours occupé une place de choix dans son coeur.

- Droit des obligations, 2e édition
- Didier Lluelles
- Benoît Moore
- ISBN : 978-2-89400-308-4
- Date de parution : 2012-09-07
2456 pages
121,00$ En rupture de stock
Le Droit des obligations, publié en septembre 2006, a reçu un accueil plus qu’encourageant de la part de la communauté des juristes du Québec. Il nous a donc semblé tout naturel d’entreprendre sa réédition.
La présente réédition rend évidemment compte des développements jurisprudentiels et doctrinaux majeurs qui se sont manifestés au cours des six années écoulées, mais aussi de l’évolution de la législation, notamment sur le terrain de la protection du consommateur (songeons aux importantes réformes de 2006-2007 et de 2009-2010). Les auteurs ont profité de cette réédition notamment pour étoffer la présentation générale du droit des obligations, en replaçant la notion d’obligation dans une perspective socio-économique, et pour approfondir certains passages concernant des notions fondamentales, comme la distinction entre les obligations civiles et les obligations naturelles et morales, l’engagement par déclaration unilatérale de volonté ou les vices innomés du consentement. La mise en œuvre de l’édition de 2012 a suivi, grosso modo, la méthode et la répartition des tâches qui avaient prévalu en 2006. L’esprit de cette édition est, en outre, fidèle à celui qui avait animé l’édition antérieure.




