- C.D.A.C.I.
- Collection Droit, biotechnologies et société
- Droit administratif
- Droit autochtone
- Droit civil
- Droit constitutionnel
- Droit des affaires
- Droit des technologies
- Droit international
- Droit pénal
- Droit public général
- Jurisprudence
- Les conférences Albert-Mayrand
- Les conférences Roger-Comtois de la Chaire du Notariat
- Les Conférences Chevrette-Marx
The Chevrette-Marx Lectures - Les journées Maximilien-Caron
- Lois et règlements
- Méthodologie
- Théorie du droit
- Titres parus antérieurement

- L'avenir de la responsabilité criminelle
- Ugo Gilbert Tremblay
- ISBN : 978-2-89400-473-9
- Date de parution : 2023-05-15
394 pages
75,00$

-
Meilleure thèse 2020
Ces dernières années, de nombreux auteurs ont prédit que la notion de responsabilité criminelle ne survivra pas aux avancées rapides des neurosciences. À leurs yeux, la notion de responsabilité criminelle serait une notion périmée, sans avenir, vouée à disparaître de la surface du droit. La raison de cette obsolescence tiendrait au décalage grandissant qui se creuse entre ce que révèlent les neurosciences au sujet du fonctionnement cérébral et la conception de l’être humain – conçu comme un être libre et pleinement maître de ses choix – qui fonde les pratiques d’imputabilité en droit pénal.
Maintenir l’idée que les délinquants sont en mesure d’agir librement s’avèrerait scientifiquement intenable à long terme et le droit n’aurait d’autre choix que de prendre acte de cette vérité inconfortable : aucun criminel n’est fondamentalement responsable de ses actes et tous sont moralement innocents. Que penser d’une telle vision et, surtout, d’une telle prédiction quant à l’avenir de la responsabilité criminelle ? Est-il plausible que le droit pénal parvienne un jour à se passer de l’une des poutres les plus centrales de son édifice ? Les neurosciences permettent-elles réellement de conclure que le libre arbitre n’est qu’une fiction ? Et si tel est le cas, est-ce bien cette fiction qui sert de fondement à la responsabilisation des auteurs de crime ?
Véritable enquête sur les fondements philosophiques, juridiques et psychologiques de l’imputabilité en droit pénal, ce livre ne manquera pas de plonger le lecteur dans de profondes méditations aussi bien sur le sens des pratiques punitives que sur la question fondamentale de la liberté humaine.
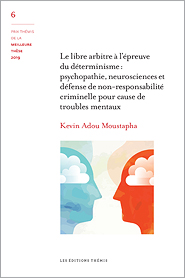
- Libre arbitre à l'épreuve du déterminisme
- Kevin Adou Moustapha
- ISBN : 978-2-89400-465-4
- Date de parution : 2022-11-15
466 pages
75,00$

-
Meilleure thèse 2019
Cette recherche a pour objet l’étude de la défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au Canada et de certains principes directeurs de la responsabilité pénale. Les troubles du psychopathe constituent un instrument pertinent pour étudier et jauger ce moyen de défense parfois décrié et ainsi faire ressortir avec le plus de justesse possible ses forces et ses faiblesses. Ainsi l’étude de l’application de la défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à la psychopathie doit nous permettre de mieux comprendre la structure de l’article 16 du C.cr canadien et l’esprit des règles gouvernant notre droit criminel. Enfin, l’application de l’article 16 du C.cr. aux troubles psychopathiques doit favoriser une meilleure compréhension de cette affection souvent considérée comme insaisissable dans sa définition par les sciences médicales et très souvent mal perçue par l’opinion publique. L’objectif ouvertement affiché de cette étude est donc de voir si la défense prévue à l’article 16 du C.cr canadien peut s’appliquer à un individu souffrant de psychopathie.

- Le droit applicable aux biens virtuels
- Dobah Carré
- ISBN : 978-2-89400-439-5
- Date de parution : 2019-03-15
488 pages
70,50$

-
Meilleure thèse 2017
bien que le marché des transactions de biens virtuels représente un important impact économique, social et juridique sur l’ensemble de la consommation, ces « biens » ne sont pourtant pas juridiquement reconnus, ni protégés par la loi ou par la jurisprudence en Amérique du Nord ou en Europe. Seuls les contrats de licence rédigés par les développeurs régissent leurs utilisations. Or, les conflits dans ce domaine peuvent devenir très complexes, car les rencontres virtuelles donnent lieu à une grande variété d’activités et sont créatrices de liens de droit entre des internautes qui peuvent se trouver physiquement à l’autre bout de la planète pour se rencontrer virtuellement dans l’environnement du cyberespace.Pour résoudre certains conflits de lois émergents dans cette matière, on se demande s’il est possible que de véritables droits réels soient créés dans le cadre de ces mondes virtuels à propos des objets virtuels afin d’appliquer les règles classiques de droit international privé. Si la résolution des conflits de lois relatifs aux biens virtuels nécessite une certaine adaptation des règles classiques, qui est possible, en l’absence de création de registres de ces droits réels, la solution la plus naturelle aux conflits de lois qui les concernent nous paraît passer par une application des règles de conflit propres aux droits d’auteur afin de protéger la créativité des joueurs et du maître du jeu.

- Décisions judiciaires en matière de garde d'enfants : contribution à l’étude de l’influence des marqueurs identitaires du juge
- Johanne Clouet
- ISBN : 978-2-89400-396-1
- Date de parution : 2017-06-01
330 pages
51,00$

330 pages
22,00$

-
Meilleure thèse 2016
l’« intérêt de l’enfant » est un concept fondamental en droit de la famille puisqu’il constitue le critère déterminant dans toute décision qui concerne l’enfant. Le Code civil du Québec énonce, au second alinéa de l’article 33, les facteurs qui doivent servir à le déterminer. Alors que certains se sont intéressés à ses origines et à son évolution, ce livre explore les diverses interprétations qu’il reçoit de la part des tribunaux dans les décisions relatives à la garde des enfants dans un contexte post-rupture, et ce, à la lumière du genre et de l’âge du décideur. S’intéressant au processus cognitif qui préside à la réflexion des décideurs, l’auteure vise à cerner, à travers une analyse interdisciplinaire, les facteurs humains et les forces sociales qui structurent les expériences et qui sont susceptibles d’avoir un impact sur les décisions judiciaires.
L’ouvrage est divisé en deux parties. La première partie, de facture théorique, vise à cerner les contours des concepts juridiques d’autorité parentale, de garde et d’intérêt de l’enfant en droit civil québécois. Se situant au carrefour du juridique, de l’histoire et du psychosocial, la deuxième partie, quant à elle, est consacrée à l’étude des valeurs, des idéologies et des traits caractéristiques dominants que sous-tendent le genre et la génération du juge et à leur influence sur la teneur des jugements qu’il prononce.

- Jalons pour une théorie pragmatique de l’interprétation du contrat : du temple de la volonté à la pyramide de sens
- Vincent Caron
- ISBN : 978-2-89400-384-8
- Date de parution : 2017-01-19
452 pages
73,50$

-
Meilleure thèse 2015
Jalons pour une théorie pragmatique de l’interprétation… Le terme interprétation est polysémique : il réfère à la fois au processus et à son résultat. Une revue des différents aspects de la notion permet de mieux saisir l’ampleur et l’importance de cette opération dans le Droit. Considérant le contrat avant tout comme un acte de communication, la pragmatique permet d’expliquer pourquoi et comment différentes méthodes interprétatives coexistent au sein de la communauté juridique. D’ailleurs, la théorie pragmatique recentre l’activité interprétative sur l’interprète, véritable créateur du sens, contrairement à la théorie classique centrée sur l’intention des contractants.Du temple de la volonté… Longtemps envisagée comme mesure exclusive du contenu contractuel, la volonté joue traditionnellement un rôle important dans l’explication du processus et du résultat interprétatif. Les deux canons de l’interprétation classique, la recherche de l’intention commune des contractants ainsi que le dogme de l’acte clair, constituent les colonnes d’un temple vouant un culte à la volonté. Si ces deux fictions, sévèrement critiquées par les juristes, sont toujours employées aujourd’hui, c’est qu’elles jouent d’importantes fonctions de régulation, de justification et de dissimulation.À la pyramide de sens… En délaissant les fictions, il appert que le sens est influencé à la fois par trois facteurs distincts : volonté, logique et légitimité. Si ces trois facteurs jouent un rôle important dans l’interprétation, leur hiérarchie varie d’un interprète à l’autre. Afin d’être convaincant, le plaideur a donc intérêt à déployer une argumentation combinant à la fois ces trois facteurs de sens.




