- C.D.A.C.I.
- Collection Droit, biotechnologies et société
- Droit administratif
- Droit autochtone
- Droit civil
- Droit constitutionnel
- Droit des affaires
- Droit des technologies
- Droit international
- Droit pénal
- Droit public général
- Jurisprudence
- Les conférences Albert-Mayrand
- Les conférences Roger-Comtois de la Chaire du Notariat
- Les Conférences Chevrette-Marx
The Chevrette-Marx Lectures - Les journées Maximilien-Caron
- Lois et règlements
- Méthodologie
- Théorie du droit
- Titres parus antérieurement

- Essai sur les attributs et certificats environnementaux de la production d'électricité : aspects juridiques de la nature, de la création, de l'échange, de la revendication et du retrait
- Ludovic Fraser
- ISBN : 9782894005071
- Date de parution : 2025-03-31
85 pages
60,00$

Essai sur les attributs et certificats environnementaux de la production d'électricité : aspects juridiques de la nature, de la création, de l'échange, de la revendication et du retrait
Face aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés, certains gouvernements et instances privées ont instauré des programmes de valorisation de l’énergie propre et/ou renouvelable.
Cet essai juridique offre une analyse comparative entre le Québec et les États-Unis, en se concentrant particulièrement sur le Massachusetts, pour explorer les nuances et les similitudes des régimes juridiques applicables au cycle de vie des attributs environnementaux de sources spécifiques de production d’électricité.
À travers une analyse approfondie, cet ouvrage explore les nuances complexes entourant la définition, la nature et la qualification des attributs et certificats environnementaux. Chaque aspect juridictionnel est minutieusement examiné pour éclairer les lecteurs sur les similitudes et les différences entre ces deux systèmes juridiques.
En dévoilant les marchés et programmes (volontaires et obligatoires) et les mécanismes de création de traçage et de retrait des certificats, l’auteur offre une perspective éclairante sur les défis et les opportunités auxquels sont confrontés les participants du marché. De plus, des thèmes cruciaux tels que la commercialisation, la dévolution légale, la responsabilité et le transfert sont explorés avec rigueur, offrant une compréhension profonde des enjeux juridiques contemporains.
À la croisée du droit de l’environnement et du droit des affaires, cet essai offre une perspective unique sur la manière dont les États-Unis abordent les défis de la commercialisation de l’électricité produite par des sources spécifiques offrant ainsi des pistes de réflexion pour la résolution d’enjeux similaires au Québec.
Que vous soyez un praticien du droit, un universitaire ou simplement un citoyen concerné par la valorisation des ressources naturelles du Québec, cet essai constitue une ressource précieuse pour naviguer dans le paysage complexe du droit « commercial » de l’environnement.

- Louis-Hippolyte La Fontaine (1808-1864) : luttes politiques et judiciaires
- Michel Morin
- Denyse Baillargeon
- Jean-Christop Bédard-Rubin
- Christian Blais
- Julien Bich-Carrière
- E.A. Heaman
- Jean-Philippe Garneau
- Maxime Gohier
- Serge Joyal
- ISBN : 978-2-89400-508-8
- Date de parution : 2025-03-26
316 pages
35,00$

Louis-Hippolyte La Fontaine (1808-1864) : luttes politiques et judiciaires
Figure politique remarquable et remarquée de son temps, Louis-Hippolyte La Fontaine est surtout connu pour son action politique au cours de la période trouble des Rébellions de 1837-38 et de l’Acte d’Union de 1840.
Ses activités d’avocat, de procureur général et de juge, ainsi que le contexte sociojuridique et intellectuel dans lequel elles s’inscrivent, ont été fort peu étudiées.
Le présent ouvrage réunit des contributions qui explorent ces enjeux, notamment les multiples significations du concept de race, les droits des femmes, le statut des Autochtones et la primauté du droit, en plus de traiter de sa prolifique carrière juridique, souvent méconnue du grand public.
Il constitue le prolongement d’un symposium qui s’est déroulé le 14 avril 2023 dans le but de susciter un renouveau dans la réflexion sur la vie de ce personnage historique. Des experts de divers horizons nous offrent cet ouvrage collectif portant sur des pans méconnus de la vie professionnelle de La Fontaine, qui culmine avec sa nomination au poste de juge en chef du Bas-Canada.
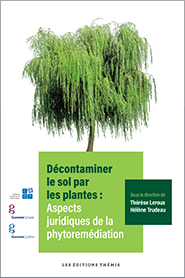
- Décontaminer le sol par les plantes
- Thérèse Leroux
- Hélène Trudeau
- ISBN : 978-2-89400-403-6
- Date de parution : 2024-11-08
251 pages
50,00$

- La protection de l’environnement figure parmi les préoccupations de la population québécoise et ces dernières nous amènent à modifier nos comportements. L’emphase est souvent mise sur les répercussions futures de nos agissements, mais il nous faut aussi réagir à nos activités passées ayant altéré notre milieu. La restauration des sols contaminés par exemple par des hydrocarbures ou encore par des métaux lourds s’inscrit dans cette démarche réparatrice. La recherche d’une technologie la mieux adaptée pour dépolluer ces terrains a orienté les travaux d’une équipe de scientifiques animés par le souci de les réhabiliter grâce à une approche dite « in situ ». En effet, comment tirer avantage des plantes associées à des microorganismes présents dans le sol pour récupérer ces contaminants? Pour répondre à cette question, un groupe de spécialistes provenant des sciences biologiques auquel se sont joints des collègues de sciences humaines ont conjugué leurs efforts. En tant que juristes, nous avons collaboré à ce projet d’envergure, nommé GenoRem, en brossant le tableau de l’encadrement normatif visant l’utilisation des plantes pour la décontamination des sols et en proposant des avenues pour promouvoir l’essor de la phytoremédiation.Le présent ouvrage vous présente le fruit de nos travaux qui se sont concentrés autour de deux axes. Tout d’abord, nous avons examiné l’alliance de la science et du droit au bénéfice de la phytoremédiation et à cette occasion, nous avons revisité les notions de « développement durable » et de « principe de précaution », assises de cette technologie. Parallèlement, nous avons étudié l’encadrement juridique de la phytoremédiation applicable aux projets de décontamination tant ici au Québec, au Canada qu’à l’étranger, soit en France et aux États-Unis. Ce tour d’horizon des règles en vigueur nous a permis de dégager des constats à partir desquels nous proposons une démarche plus dynamique apte à favoriser le développement et l’usage de technologies de décontamination in situ comme la phytoremédiation. Parmi les composantes de cette proposition figurent, en plus d’un appui indéfectible à la recherche, un partage et un transfert plus efficients des connaissances scientifiques auprès des différents intervenants du secteur de la décontamination des sols; les autrices du présent ouvrage ambitionnent concourir à cette démarche.
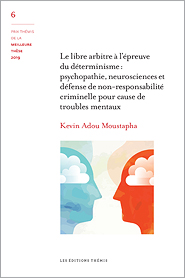
- Libre arbitre à l'épreuve du déterminisme
- Kevin Adou Moustapha
- ISBN : 978-2-89400-465-4
- Date de parution : 2022-11-15
466 pages
75,00$

- Cette recherche a pour objet l’étude de la défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au Canada et de certains principes directeurs de la responsabilité pénale. Les troubles du psychopathe constituent un instrument pertinent pour étudier et jauger ce moyen de défense parfois décrié et ainsi faire ressortir avec le plus de justesse possible ses forces et ses faiblesses. Ainsi l’étude de l’application de la défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à la psychopathie doit nous permettre de mieux comprendre la structure de l’article 16 du C.cr canadien et l’esprit des règles gouvernant notre droit criminel. Enfin, l’application de l’article 16 du C.cr. aux troubles psychopathiques doit favoriser une meilleure compréhension de cette affection souvent considérée comme insaisissable dans sa définition par les sciences médicales et très souvent mal perçue par l’opinion publique. L’objectif ouvertement affiché de cette étude est donc de voir si la défense prévue à l’article 16 du C.cr canadien peut s’appliquer à un individu souffrant de psychopathie.

- La jeunesse au carrefour de la famille, de la communauté, du droit et de la société
- Pierre Noreau
- Dominique Goubau
- Marie-Christine Saint-Jacques
- Shauna Van Praagh
- Valentine Fau
- Caroline Robitaille
- ISBN : 978-289400-454-8
- Date de parution : 2021-06-04
- L’évolution des droits de la jeunesse est une expression de l’évolution sociale elle-même. Le droit ne peut jamais être conçu, interprété ou appliqué comme une certitude. Il doit au contraire répondre aux exigences de l’environnement dans lequel vivent l’enfant et l’adolescent. C’est en cherchant à tenir compte de cette réalité mouvante que les auteurs de cet ouvrage ont joint leurs contributions. Chacune d’elle pose la difficile question de l’ajustement constant de la normativité juridique aux conditions de vie contemporaine. Quelles sont les modalités d’une implication réelle des jeunes dans la définition de leur avenir : c’est le droit par les jeunes. Quel rôle peuvent-ils y jouer : c’est le droit avec les jeunes. Quel support offre-t-il à l’intervention sociale : c’est le droit auprès des jeunes. Cet ouvrage est le produit d’une collaboration internationale, interdisciplinaire et intergénérationnelle qui met en évidence les dimensions parfois particulières, parfois universelles, qui traversent aujourd’hui l’évolution du droit de la jeunesse.The evolution of the rights of youth can be understood as an expression of social evolution itself. Given that law is never conceived, interpreted or applied with absolute certainty, we can expect it to respond to the realities and demands of the environments in which children and adolescents live. Awareness of the constantly shifting nature of those realities characterizes the contributions that make up this collection. Every author – each in their own way – appreciates the difficulty of adjusting legal norms to the conditions of contemporary life. In what ways might young people truly define their future (law by youth)? What role can they play in the shaping of legal regulation(law with youth)? What support is offered by social intervention (law towards youth)? The product of international, interdisciplinary and intergenerational collaboration, this collection conveys the complicated dimensions, both particular and universal, of a constantly evolving picture of rights and law for young people.




