- C.D.A.C.I.
- Collection Droit, biotechnologies et société
- Droit administratif
- Droit autochtone
- Droit civil
- Droit constitutionnel
- Droit des affaires
- Droit des technologies
- Droit international
- Droit pénal
- Droit public général
- Jurisprudence
- Les conférences Albert-Mayrand
- Les conférences Roger-Comtois de la Chaire du Notariat
- Les Conférences Chevrette-Marx
The Chevrette-Marx Lectures - Les journées Maximilien-Caron
- Lois et règlements
- Méthodologie
- Théorie du droit
- Titres parus antérieurement
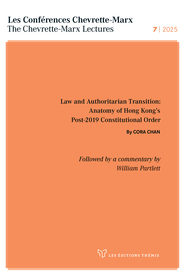
- 7 eme Conférences Chevrette-Marx The Chevrette-Marx Lectures - Law and Authoritarian Transition: Anatomy of Hong Kong’s Post-2019 Constitutional Order
- Cora Chan
- ISBN : 9782894005194
- Date de parution : 2025-09-25
55 pages
35,00$

29 pages
24,50$

7 eme Conférences Chevrette-Marx The Chevrette-Marx Lectures 2025
Law and Authoritarian Transition: Anatomy of Hong Kong’s Post-2019 Constitutional OrderIn the years since the 2019 protest movement in Hong Kong, China has sought to securitise the territory using numerous legal tools. Through a dissection of Hong Kong’s post-2019 constitutional developments, this lecture examines how the prerogative and normative domains of Ernst Fraenkel’s “dual state” legal order can interact in ways that both facilitate and impede authoritarianism. In doing so, the lecture not only reveals the varied character of legality in today’s Hong Kong; it also illuminates the paradoxical roles played by law in authoritarian transitions. These insights are particularly pertinent at a time of global crisis for liberal constitutionalism.
– Cora Chan

- Le Code civil : un incontournable? Réflexions juridiques issues d’un cycle de conférences
- Catherine Chesnay
- Michel Deschamps
- Véronique Fortin
- Felix Germek
- Dalia Gesualdi-Fecteau
- Elisabeth Greissler
- Geneviève Motard
- Jacqueline Ohayon
- Élise Charpentier
- ISBN : 978-2-89400-518-7
- Date de parution : 2025-07-24
140 pages
35,00$

Le Code civil : un incontournable?
Réflexions juridiques issues d’un cycle de conférences
Ce livre rassemble les contributions présentées lors d’un cycle de conférences organisé par la Chaire Jean-Louis Baudouin, autour du thème : « Le Code civil : un incontournable? ». Ce projet intellectuel propose une réflexion approfondie à partir de la disposition préliminaire du Code civil du Québec.
Cette disposition affirme que le Code civil du Québec « est constitué d’un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l’esprit ou l’objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger ».
Le cycle a réuni des spécialistes de divers domaines juridiques, souvent extérieurs au droit civil, afin d’explorer les rapports entre le Code civil et les autres branches du droit. Ces échanges ont permis de mettre en lumière la portée transversale du Code civil et son rôle structurant dans l’architecture juridique québécoise.

- Essai sur les attributs et certificats environnementaux de la production d'électricité : aspects juridiques de la nature, de la création, de l'échange, de la revendication et du retrait
- Ludovic Fraser
- ISBN : 9782894005071
- Date de parution : 2025-03-31
85 pages
60,00$

Essai sur les attributs et certificats environnementaux de la production d'électricité : aspects juridiques de la nature, de la création, de l'échange, de la revendication et du retrait
Face aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés, certains gouvernements et instances privées ont instauré des programmes de valorisation de l’énergie propre et/ou renouvelable.
Cet essai juridique offre une analyse comparative entre le Québec et les États-Unis, en se concentrant particulièrement sur le Massachusetts, pour explorer les nuances et les similitudes des régimes juridiques applicables au cycle de vie des attributs environnementaux de sources spécifiques de production d’électricité.
À travers une analyse approfondie, cet ouvrage explore les nuances complexes entourant la définition, la nature et la qualification des attributs et certificats environnementaux. Chaque aspect juridictionnel est minutieusement examiné pour éclairer les lecteurs sur les similitudes et les différences entre ces deux systèmes juridiques.
En dévoilant les marchés et programmes (volontaires et obligatoires) et les mécanismes de création de traçage et de retrait des certificats, l’auteur offre une perspective éclairante sur les défis et les opportunités auxquels sont confrontés les participants du marché. De plus, des thèmes cruciaux tels que la commercialisation, la dévolution légale, la responsabilité et le transfert sont explorés avec rigueur, offrant une compréhension profonde des enjeux juridiques contemporains.
À la croisée du droit de l’environnement et du droit des affaires, cet essai offre une perspective unique sur la manière dont les États-Unis abordent les défis de la commercialisation de l’électricité produite par des sources spécifiques offrant ainsi des pistes de réflexion pour la résolution d’enjeux similaires au Québec.
Que vous soyez un praticien du droit, un universitaire ou simplement un citoyen concerné par la valorisation des ressources naturelles du Québec, cet essai constitue une ressource précieuse pour naviguer dans le paysage complexe du droit « commercial » de l’environnement.

- Louis-Hippolyte La Fontaine (1808-1864) : luttes politiques et judiciaires
- Michel Morin
- Denyse Baillargeon
- Jean-Christop Bédard-Rubin
- Christian Blais
- Julien Bich-Carrière
- E.A. Heaman
- Jean-Philippe Garneau
- Maxime Gohier
- Serge Joyal
- ISBN : 978-2-89400-508-8
- Date de parution : 2025-03-26
316 pages
35,00$

Louis-Hippolyte La Fontaine (1808-1864) : luttes politiques et judiciaires
Figure politique remarquable et remarquée de son temps, Louis-Hippolyte La Fontaine est surtout connu pour son action politique au cours de la période trouble des Rébellions de 1837-38 et de l’Acte d’Union de 1840.
Ses activités d’avocat, de procureur général et de juge, ainsi que le contexte sociojuridique et intellectuel dans lequel elles s’inscrivent, ont été fort peu étudiées.
Le présent ouvrage réunit des contributions qui explorent ces enjeux, notamment les multiples significations du concept de race, les droits des femmes, le statut des Autochtones et la primauté du droit, en plus de traiter de sa prolifique carrière juridique, souvent méconnue du grand public.
Il constitue le prolongement d’un symposium qui s’est déroulé le 14 avril 2023 dans le but de susciter un renouveau dans la réflexion sur la vie de ce personnage historique. Des experts de divers horizons nous offrent cet ouvrage collectif portant sur des pans méconnus de la vie professionnelle de La Fontaine, qui culmine avec sa nomination au poste de juge en chef du Bas-Canada.




